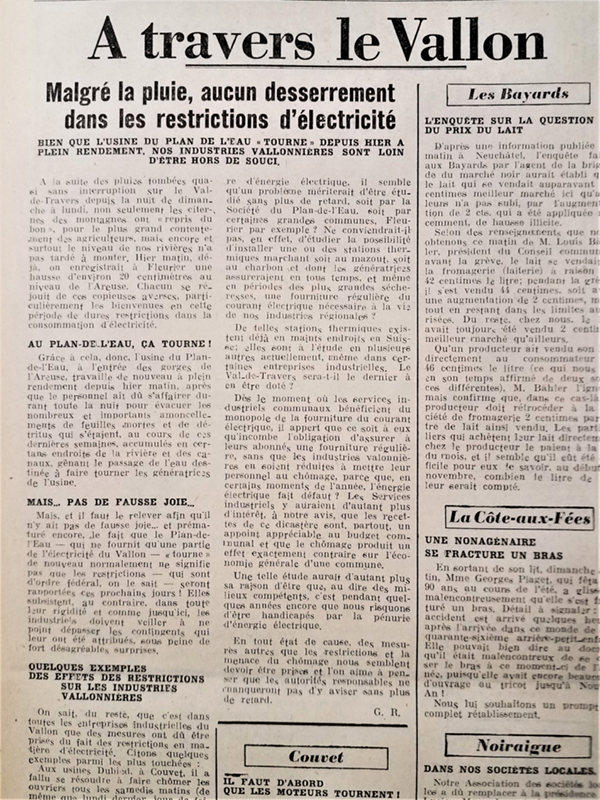Hiver sous restrictions
L’électricité posait déjà question en 1947
Alors que la menace de pénurie d’électricité inquiète l’Europe et la Suisse en 2022, un bref coup d’œil en arrière nous apprend que cette problématique faisait déjà la une il y a… 75 ans ! Les causes sont un peu différentes mais les conséquences pourraient être similaires. Alors pourquoi ne pas se pencher un instant sur ce qu’il s’était passé à l’époque, lorsque le courant était venu à manquer ? Sans tomber dans l’alarmisme inutile, cela fera peut-être réfléchir ! Car c’est tout le secteur industriel qui avait été touché, laissant craindre un puissant chômage de masse.
D’où provient l’électricité produite en Suisse ?
C’est la première chose à poser avant de s’interroger sur une éventuelle pénurie. La force hydraulique fournit plus de 60% de l’énergie (61%) quand le nucléaire représente près d’un tiers de celle-ci (29%). A elles-seules, elles apportent 90% de l’électricité helvétique. Les énergies renouvelables (environ 8%) et les énergies fossiles (quelque 2%) sont donc loin derrière. Par ailleurs, la Suisse importe de l’électricité pendant le semestre d’hiver depuis plusieurs années. Et elle en exporte durant celui d’été, quand sa production est excédentaire. En 2021, elle a importé plus d’électricité qu’elle n’en a exporté. Les importations provenaient principalement d’Allemagne et de France.
Quid du gaz ?
Le gaz naturel couvre environ 15 % des besoins énergiques de la Suisse. Il est surtout nécessaire pour le chauffage et la cuisine des ménages de notre pays. Quelque 300’000 ménages se chauffent au gaz. L’industrie et l’artisanat sont par ailleurs de gros utilisateurs de gaz. Or, la Confédération possède bien des ressources mais pas celle-ci. Pour se fournir en gaz naturel, la Suisse se connectait les dernières années aux réseaux de ses voisins européens, lui-même alimenté par la Russie (43%). Mais il provenait aussi de la Norvège (22%) et quelques autres pays de l’UE. Devant ses chiffres, et dans l’attente de trouver des alternatives fiables à long terme avec d’autres pays que la Russie, il devient vite évident que cette ressource pourrait se faire rare, sur notre sol, si l’hiver se fait rude. La guerre en Ukraine, les sanctions et les contre-sanctions entre les pays européens et la Russie étant naturellement en toile de fond de cette question.
La pénurie coule-t-elle vraiment de source ?
On l’a vu précédemment, le gaz ne couvre que 15% des besoins énergétiques de la Suisse. La guerre en Ukraine et ses conséquences ne devraient donc pas avoir un impact si fort sur notre pays. Où je me trompe ? Et bien oui, je me trompe avec ce raisonnement ! Il est clair que l’interruption de livraison de gaz par la Russie, à une partie de l’Europe, et l’arrêt de la moitié des centrales nucléaires française (pour entretien), ne créent pas un contexte favorable. Mais la véritable clé du problème énergétique découle de l’hydraulique. Rappelez-vous, c’est plus de 60% de notre électricité qui est assurée grâce à elle. Le problème ne vient donc pas directement du gaz mais du manque d’alternative dont dispose la Suisse. Tout spécialement quand l’hydraulique commence à tourner au ralenti.
Et dans ce domaine, c’est un autre événement de ces derniers mois qui a posé quelques difficultés. La sécheresse estivale a agi négativement sur la production hydroélectrique européenne. Elle y a diminué de 20%. La Suisse n’y a pas échappé, même si elle a limité la casse « grâce » ou à cause de la fonte accélérée des glaciers. Ainsi, les spécialistes de la Commission fédérale de l’électricité estime que la Suisse a limité la perte à hauteur de 12%.
75’000 litres d’eau perdus à la seconde !
La moitié de l’énergie hydraulique produite en Suisse provient de barrages, l’autre vient de petites centrales installées au fil de l’eau. Comme celles de la SEVT le long de l’Areuse par exemple. En Valais, le barrage de Gebidem retient plus de 9,2 millions de m3 d’eau, soit l’équivalent d’environ 4000 piscines olympiques. Cette or bleu coule depuis l’Aletsch, le plus grand glacier des Alpes. En 2022, la canicule a été telle que le barrage n’a pas pu faire face à toute la quantité d’eau provenant du glacier. Ainsi, près de 75’000 litres d’eau se seraient écoulés chaque seconde par-dessus le barrage, selon Simon Bradley de Swissinfo. Ce qui constitue autant d’eau qui n’a pas pu faire actionner les turbines entre juillet et août et qui est définitivement perdu.
Tout le problème est maintenant clarifié : la Suisse se repose sur plus de 60% d’énergie hydraulique. Mais cette énergie est problématique quand l’eau vient à manquer (car les turbines ne tournent pas assez) et quant l’eau arrive en excès (car de l’eau échappe aux turbines). Le dérèglement climatique ne plaide pas en sa faveur non plus. Le manque d’enneigement lors de certains derniers hivers, et donc le manque d’eau lors de la fonte des neiges, est aussi pointé du doigt par la Commission fédérale d’électricité.
Grande incertitude et espoirs !
Si certains spécialistes et politiciens redoutent sérieusement que des coupures interviennent durant l’hiver, d’autres ne semblent pas y croire, malgré les avertissements présentés ci-dessus. Dans l’incertitude, il vaut mieux se prémunir, s’accordent-ils à dire. C’est pourquoi la Confédération a lancé une campagne nationale d’économies d’énergie, relayée par les cantons et les communes. Le seul autre véritable motif d’espoir vient encore une fois de Mère nature.
Bien qu’il ne s’agisse que de scénarios, qui plus est lointains, des experts prévoient une augmentation des précipitations de 20% en hiver d’ici la fin du siècle. Dans le même temps, il y aurait une diminution d’autant (voire dans une proportion légèrement inférieure) des précipitations en été. En résumé, il devrait en résulter un transfert naturel de la production estivale vers la production hivernale. Ce qui conduirait à nous offrir davantage d’électricité durant les mois froids, là où les ménages en ont le plus besoin !
1947: restrictions et pénurie au Vallon
La dépendance énergétique de la Suisse, et en particulier du Vallon, a déjà créé quelques précédents en ce qui concerne les restrictions d’électricité. En 1947, ces restrictions sont qualifiées de dures dans le Courrier d’alors. Les génératrices de l’usine du Plan-de-l’Eau étaient à l’arrêt une longue période suite à un grand épisode de sécheresse. Les pluies tombées au début du mois de novembre avaient donc été reçues avec bonheur par les Vallonniers. « Même si le Val-de-Travers ne se fournit qu’en partie en électricité via l’usine du Plan-de-l’Eau et que celles-ci ne signifient pas que les restrictions fédérales ne soient rapportées ces prochains jours », dit l’article. En d’autres mots, la quantité d’eau tombé n’allait pas mettre fin à la sécheresse si facilement. Et donc, le manque d’électricité à disposition allait se poursuivre.
Il est aussi précisé que « les industriels doivent veiller à ne point dépasser les contingents qui leur ont été attribués, sous peine de fortes désagréables surprises ». En effet, face à la situation, les entreprises industrielles du Vallon avaient été soumises à de sérieuses restrictions d’électricité. L’usine Dubied faisait chômer les ouvriers tous les samedis matin, en plus de la fermeture des ateliers les après-midi. Pour la Société industrielle de caoutchouc, qui représentait 50% de la consommation totale du village de Fleurier, il est précisé « qu’il faudra mettre à l’arrêt les grosses machines et concentrer les forces sur de petits articles, peu coûteux en énergie ». A la fabrique d’ébauche Fleurier SA, la prise des machines a aussi été retirée pour faire des économies. Dernier exemple, la fabrique de pâte de bois de Saint-Sulpice a réduit sa production de 20%. Plus globalement, le Courrier parle d’une réduction possible de l’activité de tout le secteur industriel, de 20 à 30%. Avec un chômage de masse possible à la clé.
L’appel en faveur de plus de mazout et de charbon
Face au constat d’une (trop) grande dépendance énergétique à l’hydraulique, il était déjà demander de varier les sources d’approvisionnement en énergie. La presse poussait à la construction de stations thermiques fonctionnant au charbon ou au mazout. « De telles stations thermiques existent déjà en maints endroits en Suisse, même dans certaines entreprises industrielles. Le Val-de-Travers sera-t-il le dernier à en être doté », se demandait le journaliste du Courrier Gaston Rub. Détaillant ensuite son propos : « Dès le moment où les services industriels communaux bénéficient du monopole de la fourniture du courant électrique, il appert que ce soit à eux qu’incombe l’obligation d’en assurer une fourniture régulière. » Depuis ses articles, de l’eau a coulé sous les ponts mais pas tant que ça, quand on s’aperçoit que l’hydraulique représente encore plus de 60% de l’énergie fournie en Suisse aujourd’hui.
Certes, des choses ont bougé dans le canton depuis 1947, avec notamment la construction de la centrale à gaz de Cornaux en 1967, et elle continuent d’évoluer avec de plus en plus de solutions « propres ». Mais celle-ci sont efficaces à une échelle très régionale. Le réseau de valorisation des déchets de l’Arc jurassien Vadec fournit par exemple de l’électricité à 11’000 ménages « seulement ». Encore plus près de nous, Agrio Bio Val SA (qui traite des déchets agricoles notamment) injecte directement l’énergie qu’elle crée dans le réseau. Elle crée aussi un peu d’énergie via le solaire et le thermique. Au total, ce sont 120 appartements qui sont chauffés ainsi par le chauffage à distance.
Vers une centrale à gaz de réserve à Cornaux ?
Pour conclure, on peut dire que les petits pas sont importants mais largement insuffisants pour offrir des garanties viables et durables à cette dépendance encore marquée à l’hydraulique.
Et donc, le moindre grain de sable, comme une guerre ou une sécheresse, mène rapidement à se poser la question fatidique de la pénurie et celle des restrictions. En début d’année, le Conseil fédéral a pris le problème à bras le corps en affirmant vouloir « envisager de construire deux ou trois centrales à gaz de réserve pour face aux risques de pénurie d’électricité ». L’une des solutions pourrait prendre racine à Cornaux. La centrale existante (Cornaux I) ou la construction d’une nouvelle (Cornaux II) pourrait constituer une solution de secours en tant que centrale de réserve. Dans tous les cas, cela demanderait trois à quatre ans avant que ce projet devienne effectif. Ce ne saurait donc constituer une solution pour l’hiver 2022 !